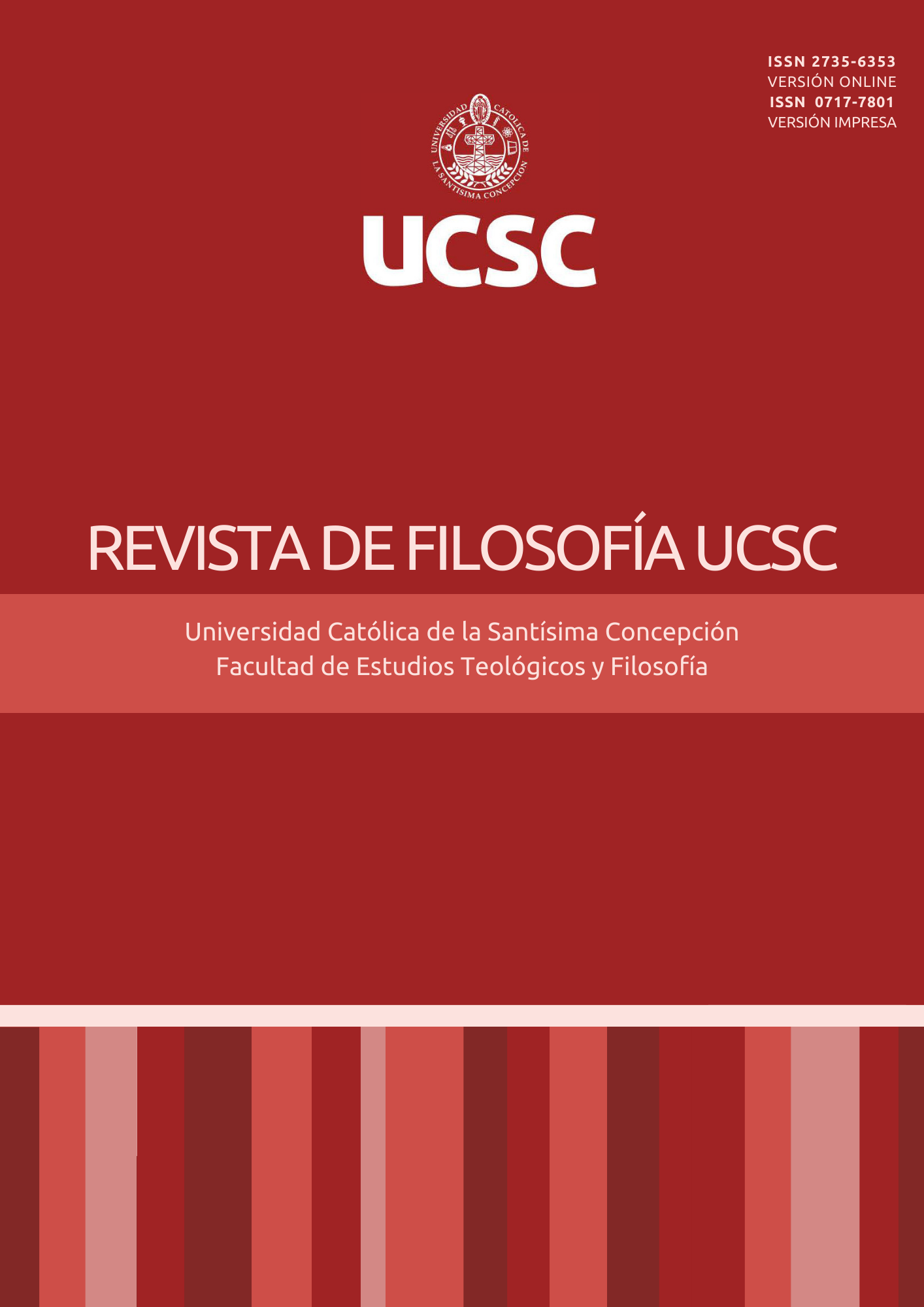Le langage phénoménologique sur le mystère chrétien
Contenu principal de l'article
Résumé
Cet article explore la relation entre le langage humain, la philosophie et la théologie, en mettant l'accent sur la difficulté d'exprimer le divin. Il part du postulat que le langage, à la fois extérieur et intérieur, est propre à l'homme, et examine sa capacité à articuler la transcendance. D'une perspective phénoménologique, l'étude analyse comment la philosophie attribue des concepts aux phénomènes, tandis que la théologie rencontre des obstacles lorsqu'elle tente de nommer Dieu, car le divin semble dépasser les limites du langage. L'article suggère que, bien que le langage soit essentiel à la communication et à la pensée, sa capacité à exprimer la réalité divine reste limitée. Le silence apparaît alors comme une voie herméneutique plus appropriée pour approcher le sacré, car la nature de Dieu transcende les concepts humains, révélant ainsi les limites du langage face à l'ineffable.
Details de l'article
Rubrique

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
Le UCSC Journal of Philosophy est en libre accès et ne facture pas sa publication. En outre, il réglemente sa politique de droits d'auteur et l'accès à ses archives conformément à la licence publique internationale Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Il est donc permis de partager (reproduire et distribuer le matériel sur tout support ou dans tout format) et d'adapter (modifier, transformer et créer à partir du matériel) à condition que le crédit approprié soit donné, y compris la citation avec les données correspondantes. En outre, il n'est pas permis d'utiliser le matériel à des fins lucratives.
Comment citer
Références
Aristote (1992). Métaphysique. Flammarion
Bergson, H. (1889). Sur les données immédiates de la conscience. PUF.
Berkeley, G. (1971). Traité des principes de la connaissance humaine. Les Belles Lettres.
Boileau, N. (1999). Art poétique, chant I. Flammarion.
Chauchard, P. (1956). Le langage et la pensée. PUF.
Derrida, J. (1993). Sauf le nom. Galilée.
Descartes, R. (1937). Œuvres, lettres. Gallimard.
Hegel, W. (2010). La Phénoménologie de l’Esprit. Pernon.
Heidegger, M. (1976). Acheminement vers la parole. Gallimard.
Husserl, E. (1947). Méditations cartésiennes, deuxième méditation. Vrin.
Kant, E. (2010). Fondements de la métaphysique des mœurs. Pernon.
Kant, E. (2012). Critique de la raison pure. Gallimard.
Leibniz, F. G. W. (1714). Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Vrin.
Lucrèce.( 1924). De rerum natura. Les Belles Lettres.
Marion, J.-L. (1982). Dieu sans l’être. Grasset.
Marion, J.-L. (1997). Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation. PUF.
Marion, J.-L. (2010). Certitude négative. Grasset.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.
Nazianze, G. (1978). Discours théologique. Poème dogmatique. Discours. Cerf.
Nietzsche, F. (1971). La généalogie de la morale. Gallimard.
Nietzsche, F. (2006). La naissance de la tragédie. Gallimard.
Parrochia, D. (1991). Le réel. Bordas.
Piajet, J. (1937). La construction du réel chez l’enfant, Delachaux & Niestlé.
Platon. (1970). Le sophiste. Belles Lettres.
Popper, K. (1963). Conjonctures et réfutations : comment nous faisons des sciences. Routledge & Kegan Paul.
Russ, J. (2011) Dictionnaire de philosophie. Hatier.
Sartre, J.-P. (1943). L’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique. Gallimard.
Sartre, J.-P. (1983). Cahiers pour une morale. Gallimard.
Techou, R. (2017). Le phénomène humain. Essai sur l’homme. Spinelle.
Wittgenstein, L. (1992). Philosophie, logique, thérapeutique. PUF.